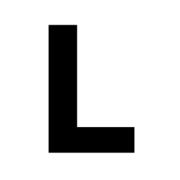Quand la SF imagine l'humain aquatique.

En 2500, la montée des eaux a englouti tous les continents. Les derniers humains survivent sur des atolls artificiels ou des embarcations de fortune, rouillées et rafistolées. Le troc et le pillage sont devenus les seules lois du monde. Marins de naissance, ces survivants n'ont jamais connu la terre ferme. Pourtant, des rumeurs circulent à propos d'une terre de légende, baptisée Dryland, qui émergerait quelque part dans cet océan sans fin.
Ce qui faisait l’originalité du scénario de Waterworld (1995), c’était son cadre : non pas un désert brûlant comme dans la plupart des films post-apocalyptiques de l’époque (comme Mad Max), mais une Terre entièrement recouverte par les océans.
Kevin Costner campe le Mariner de Waterworld, un mutant doté de branchies derrière les oreilles, de mains et de pieds palmés, et capable de voir dans l’obscurité sous-marine. Des capacités qui lui permettent de survivre dans un monde englouti, mais qui relèvent davantage de la fantasy que de la biologie. Peut-on réellement imaginer, même sous la pression du changement climatique, une évolution humaine aussi rapide vers la vie aquatique — branchies, apnée prolongée, métabolisme amphibie — en seulement quelques générations ?
L’analyse « The Genetics and Biology of Waterworld » (COAGULOPATH) souligne à quel point ces mutations sont invraisemblables. Paradoxe : capable de respirer sous l'eau, le héros doit pourtant filtrer son urine pour obtenir de l'eau potable en surface. Toutefois, cette transformation joue un rôle fort dans le récit : perçu comme une menace, il doit conquérir la confiance des survivants. La figure du mutant interroge — et si nous devions, nous aussi, nous réinventer pour survivre à l’océan qui monte ? À défaut de branchies, mieux vaut peut-être s'équiper de palmes, masque, tuba et combinaison anti-UV...
Comme le rappellent les chercheurs, "rivaliser avec des millions d'années d'évolution ne se fait pas en quelques décennies." (1) Le corps humain n’est tout simplement pas conçu pour une immersion prolongée. Même avec des équipements de plongée, nos fonctions cognitives se dégradent sous l’eau, la dextérité diminue, et le risque d’hypothermie est permanent. La pression hydrostatique, dès qu’on dépasse quelques dizaines de mètres, devient écrasante : elle exigerait une transformation irréaliste de notre cage thoracique. Quant à la thermorégulation ou à la flottabilité, elles reposeraient sur des modifications profondes de notre structure musculaire et osseuse. Enfin, respirer dans l’eau supposerait le développement de branchies artificielles compatibles avec notre physiologie — un défi encore très lointain pour la bio-ingénierie.
Les preuves d'une adaptation génétique à la plongée
Dans le monde réel, certains groupes humains ont développé des adaptations remarquables : des scientifiques ont identifié une adaptation génétique chez le peuple Bajau en Indonésie, connu comme les "nomades de la mer", qui plonge jusqu'à 70 mètres de profondeur sans équipement sophistiqué. Une étude publiée en avril 2018 a révélé que la rate des Bajau est 50% plus grande que celle d'un groupe non plongeur. Des analyses génétiques ont identifié des différences significatives, notamment sur le gène PDE10A qui régule une hormone thyroïdienne influençant la taille de la rate. Cette adaptation pourrait expliquer leur capacité à retenir leur souffle plus longtemps. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette découverte pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, non seulement en plongée libre, mais aussi dans certains contextes médicaux liés à l’hypoxie. (2)
Autre exemple : depuis des siècles, les Haenyeo, « femmes de la mer », plongent en apnée, parfois jusqu’à 15 mètres de profondeur, sans bouteille ni assistance, dans des eaux glacées pour rapporter conques et poulpes du large de l’île de Jeju, en Corée du Sud. Leur culture, matriarcale et inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco, remonte au XVIIe siècle. Une étude publiée en mai 2025 a révélé que leur incroyable résistance n’est pas uniquement due à leur entraînement, mais aussi à des particularités génétiques. Deux variantes spécifiques leur confèrent une meilleure tolérance au froid et une protection cardiovasculaire, notamment sous pression. Les tests physiologiques ont aussi montré un ralentissement cardiaque important lors des plongées, preuve d’une adaptation au manque d’oxygène, acquise principalement par des années de pratique. Avec moins de 5 000 Haenyeo actives aujourd’hui, ce savoir ancestral est en voie de disparition. (3)
Si la science atteste de remarquables adaptations génétiques chez les Bajau et les Haenyeo, celles-ci restent des ajustements subtils, très loin des mutations radicales imaginées par la science-fiction pour peupler les Waterworld de demain.
Respirer dans l'eau : un rêve irréalisable ?
Respirer dans l’eau, tel un poisson, quel plongeur sous-marin n'en a pas un jour rêvé ? Plutôt que de retenir son souffle ou de s’encombrer de lourdes bouteilles d’air comprimé, comment pourrions-nous retourner vivre un jour en milieu aquatique ?
"Respirer dans l'eau à l'aide de branchies ? L'embryon humain présente, à la quatrième et à la cinquième semaine, des arcs branchiaux qui formeraient des poches et des fentes branchiales. Ces fentes avaient déjà été observées par les embryologistes du XIXe siècle, qui y voyaient une trace d'un ancien stade « poisson ». Hélas, ces arcs branchiaux se résorbent au cours de l'embryogenèse. Suffirait-il alors d'inhiber le gène à l'origine de cette régression pour conserver les branchies ? C'est loin d'être aussi simple. Une cascade complexe de gènes, et non un gène unique, intervient dans le processus : modifier un élément chamboulerait l'ensemble de la chaîne... Si certains états de caractères morphologiques sont réversibles au cours de l'évolution, ce n'est pas le cas de complexes anatomiques entiers." (4)
En raison de cette complexité génétique, la perspective de conserver des branchies chez les humains demeure peu réaliste. Si l'évolution naturelle semble avoir fermé cette porte, la science-fiction, elle, peut néanmoins imaginer un scénario inverse : celui d’humains cybernétiquement et/ou biologiquement modifiés pour vivre en milieu aquatique. Les baleines en sont un exemple : descendantes de mammifères terrestres, elles ont progressivement réintégré l’océan (sur plusieurs dizaines de millions d’années), jusqu’à devenir parfaitement adaptées à la vie marine.
De l'océan de Waterworld à celui d'Avatar
Mariner, le mutant de Waterworld, représente une nouvelle humanité post-catastrophe, qui symbolise la nécessité pour l'homme de se transformer physiquement pour s'adapter à un environnement radicalement nouveau. Ce concept d'adaptation biologique est aussi le moteur de la saga Avatar. Comme l'explique James Cameron, elle célèbre notre « capacité à évoluer dans des environnements différents ». Dans Avatar : La Voie de l’eau (2022), le réalisateur plonge le spectateur au cœur des villages côtiers des Metkayina, un clan de Pandora. Leur évolution illustre une divergence ancienne avec les Na’vis des forêts : leurs corps, façonnés par des millénaires de vie océanique, en font des êtres hybrides. Leur queue leur sert de moyen de propulsion, à la manière des phoques ou des loutres. Bien qu’ils respirent de l’air, ils ont développé une capacité remarquable à retenir leur souffle sur de longues durées. Leurs yeux sont protégés par des membranes nictitantes, semblables à celles des crocodiles ou des hiboux. (5)
Les Rifteurs, des humains augmentés pour les grands fonds
Peter Watts, ancien biologiste marin et célèbre auteur de science-fiction, est reconnu pour son roman Vision aveugle, une référence sur le premier contact extraterrestre. Il a aussi écrit la trilogie Rifteurs, qui développe l'adaptation biotechnologique de l'humain à l'océan, notamment par la greffe d'un respirateur artificiel remplaçant le poumon gauche.
"Son roman met en scène une équipe placée dans une station de production d’énergie géothermique située sur une dorsale océanique, par trois kilomètres de fond : une installation indispensable, à la fin de la décennie 2040, au maintien de l’approvisionnement en électricité d’une Amérique du Nord livrée au contrôle des Corporations. Le lecteur découvrira rapidement que cette équipe (les rifteurs du titre de la trilogie), formée de personnes adaptées par cybernétique et manipulations génétiques aux grandes profondeurs, a été choisie en fonction de deux types de profils psychologiques très particuliers, et censés leur permettre de fonctionner dans un environnement horriblement oppressant." (6)
Équipés de branchies artificielles capables de les faire respirer dans l'eau sous haute pression, les rifteurs sont protégés par des calottes oculaires et des combinaisons sophistiquées ; des altérations génétiques leur permettent d'acclimater leur vision à l'obscurité. À chaque incursion en eaux profondes, leurs implants libèrent des neuro-inhibiteurs et leur permettent de boire de l'eau de mer.
"Ballard détache sa combinaison jusqu’à la taille. Juste sous son sein gauche, la prise de l’électrolyseur saille entre ses côtes. Clarke observe vaguement le disque perforé dans la chair de Ballard. C’est par là que l’océan entre en nous, pense-t-elle. Elle le sait depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, ce fait semble revêtir une nouvelle signification. On l’aspire en nous, on lui vole son oxygène et on le recrache." Extrait de Starfish (1999) - trilogie Rifteurs.
Des modes d'adaptation physique à la vie aquatique... pour après-demain
Dans La Terre bleue de nos souvenirs (2012) d'Alastair Reynolds, une partie de l'humanité du XXIIe siècle a choisi de vivre dans des habitats sous-marins. Pour s'adapter à cet environnement, ils ont subi des modifications génétiques qui leur permettent de respirer sous l'eau et de résister à la pression ambiante. Ces "aquatiques" ont grandi dans leurs bulles sous-marines et sont capables de nager et de respirer comme des poissons.
"Certains avaient une forme aquatique complète, mais d’autres conservaient une base anatomique de terrien, avec tous leurs membres. Une immersion prolongée ne semblait poser aucun problème à certains de ces cas limites, mais d’autres portaient toutes sortes de respirateurs légers. D’après ce que Geoffrey avait compris, le procédé complet d’aqua-transformation ne se faisait pas en un jour ; ce parcours comportait plusieurs étapes, et tout le monde ne choisissait pas de continuer les opérations chirurgicales après avoir reçu les modifications basiques." Extrait du livre d'A. Reynolds.
En imaginant le XXIIe siècle, trois scénarios d'adaptation humaine à la vie sous-marine se dessinent :
- Mode "Basique" : L'humain assisté par la technologie.
- Ce premier scénario consiste à prolonger nos capacités actuelles grâce à des équipements de plongée. Comme les respirateurs portatifs de Star Wars, des appareils miniatures permettraient des immersions, à priori jusqu'à 70 mètres de profondeur, sans modifier la "base anatomique" de notre corps. L'humain resterait un être terrestre, mais pourrait évoluer temporairement sous l'eau plus aisément qu'aujourd'hui.
- Mode "Mixte" : L'humain hybride.
- L'Homme-Amphibie d'Alexander Belyaev (1928) est un classique de la science-fiction soviétique. Le roman raconte l'histoire d'Ichthyander, un jeune homme à qui un chirurgien a transplanté des branchies de requin pour lui sauver la vie ; il peut vivre sous l'eau, mais son adaptation le limite également dans le monde terrestre. C'est un précurseur de l'idée de l'humain modifié pour l'aquatique. Il est suggéré que Belyaev a emprunté l'intrigue au roman français de 1909 L'Homme qui peut vivre dans l'eau de Jean de La Hire. Celui-ci met en scène l’Hictaner, un surhomme doté de branchies par le savant Oxus, et instrumentalisé par une organisation secrète qui projette de dominer les grandes puissances mondiales.
- Mermere (1978, revu et corrigé en 2020) est un roman centré sur les écosystèmes marins et les modes de vie susceptibles d’en assurer la préservation. Hugo Verlomme y imagine le peuple des Noés, des humains ayant quitté la terre ferme après une série de catastrophes ayant ravagé la surface. Adaptés à la vie sous-marine, ils respirent sous l’eau grâce à un organe artificiel greffé à leur gorge, l’« okam ». Répartis en différents « domaines » à travers le globe, les Noés forment une société aquatique profondément respectueuse de son environnement. Leur manière d’aménager l’espace marin témoigne d’un souci d’équilibre écologique, tout comme leurs liens étroits avec les cétacés — dauphins, orques, baleines — avec lesquels ils vivent et communiquent. En harmonie avec les espèces marines, les Noés aux yeux pourpres incarnent une nouvelle humanité, symbiotique et consciente de sa place dans l’écosystème.
- Ce modèle envisage des humains véritablement amphibies, capables de respirer aussi bien dans l’air que dans l’eau. Il s’inspire d’espèces existantes comme les polyptères ou les dipneustes, qui disposent à la fois de branchies et de poumons (7). Une telle transformation impliquerait une reconfiguration profonde de notre physiologie et de nos voies respiratoires, grâce à la bio-ingénierie, pour rendre notre corps réellement "bicompatible". Mais le résultat serait une créature si profondément modifiée qu’elle ne ressemblerait plus vraiment à un humain, à moins d’en redéfinir les contours.
- Un autre scénario, cette fois d’ordre cybernétique, apparaît dans la trilogie Rifteurs de Peter Watts : des humains y sont profondément modifiés pour résister à des pressions extrêmes et évoluer jusqu’à 3 000 mètres de profondeur. Il convient de citer aussi le roman pour la jeunesse d'Andreas Eschbach, Aquamarine (2015).
- Mode "Extrême" : La transformation complète.
- Le scénario le plus radical imagine une métamorphose totale de l’être humain pour une vie exclusivement aquatique, à l’image des cétacés. Une telle transformation impliquerait la disparition des membres, la modification du squelette, de la peau, ainsi que des systèmes respiratoire et reproducteur. Il ne s’agirait plus d’une simple assistance ou d’un compromis biologique, mais d’un changement d’espèce à part entière.
"Il restait la question de savoir si elle était née baleine ou si elle avait obtenu cette apparence à coups de génétique postnatale et d’interventions chirurgicales. [...] Il n’avait jamais rien vu comme elle, nulle part dans toute la création. Une baleine avec une intelligence humaine, ou une personne transformée en cétacé. Il ne savait pas très bien ce qui était le plus miraculeux." Extrait du livre d'A. Reynolds.
Sources :
(1) In : Respirer sous l’eau, un rêve impossible ?

Extrait de l'article : Les branchies des poissons jouent un rôle similaire à celui des poumons chez les animaux terrestres, mais elles sont adaptées à l'environnement aquatique. Elles permettent aux poissons de respirer en extrayant l'oxygène dissous dans l'eau et en éliminant le dioxyde de carbone. L'eau, étant plus dense et plus visqueuse que l'air, présente des défis particuliers pour l'échange de gaz ; les branchies sont spécialement conçues pour maximiser l'efficacité de ce processus, avec des lamelles branchiales fournissant une grande surface pour l'échange de gaz, augmentant ainsi la capacité d'absorption de l'oxygène. Elles permettent également aux poissons de maintenir un équilibre entre la concentration d'oxygène dans l'eau et celle dans leur sang, même lorsque la concentration d'oxygène dans l'eau est relativement faible.
Chez les poissons, les branchies sont des organes situés sur les côtés de la tête, composés d’une multitudes de petits vaisseaux sanguins appelés capillaires. Quand le poisson ouvre sa bouche, l’eau passe sur les branchies, et le sang contenu dans les capillaires extrait l’oxygène présent dans l’eau pour le distribuer au sein du corps de la créature. Reproduire ce résultat artificiellement est très complexe, car l’eau a une concentration en oxygène 25 000 à 50 000 fois inférieure à l’air que nous respirons. Les branchies animales se distinguent donc par leur efficacité à extraire cet oxygène si précieux.
S’il serait théoriquement possible de faire respirer un homme sous l’eau avec l’oxygène qu’elle contient, la quantité d’oxygène nécessaire est trop importante pour que la respiration d’un homme suffise à la pomper. [...] Nous aurions besoin de filtrer 10 litres d’eau par seconde pour rester en vie, sans bouger. Pour se passer de pompes mécaniques, il faudrait avoir des branchies avec une surface de 60m², et nager constamment à une vitesse de 20 centimètres par secondes. Autant dire que le système ne serait pas vraiment portable.
(2) In : https://www.geo.fr/environnement/premiere-preuve-d-une-adaptation-genetique-a-la-plongee-187835
(4) In : Article payant paru dans Pour la Science N°447 - 19 décembre 2014 - Jean-Sébastien Steyer et Roland Lehoucq
https://www.pourlascience.fr/sd/biologie/respirer-comme-un-poisson-dans-laposeau-8243.php
(5) In : Avatar : James Cameron nous explique la réalité scientifique qui a inspiré le monde aquatique de Pandora

(6) In : Une sélection d'articles pour en savoir plus sur la trilogie Rifteurs :

Un auteur exigeant avec ses lecteurs. Il a été interrogé lors du symposium Réalités de la science-fiction.
(7) In : Au commencement était le poisson: l'homme : 3,5 milliards d'années d'évolution - Neil Shubin - R. Laffont, 2009 - 243 pages
C'est à un voyage fantastique de centaines de millions d'années que nous convie le paléontologue Neil Shubin. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, nos mains furent autrefois des nageoires de poisson et notre génome est extrêmement proche de celui que possèdent les bactéries apparues il y a trois milliards et demi d'années! Le 31 mars 2006, Neil Shubin et son équipe ont fini par découvrir au-delà du cercle arctique, un animal primitif vieux de trois cent soixante-quinze millions d'années, sorte de croisement entre un poisson et un alligator. Baptisé Tiktaalik ("grand poisson des basses eaux"), ce fossile très étonnant est une sorte de chaînon manquant entre les poissons et les amphibiens. Non seulement l'animal avait des nageoires mais aussi des poignets et des doigts lui permettant de se soulever. Ce poisson très spécial nous montre donc comment les êtres vivants ont pu finir par sortir des eaux et conquérir la terre ferme.
« Nos mains ont cinq doigts comme les pattes des lézards, nos yeux, dont le cristallin est analogue à celui des animaux marins, rappellent nos origines aquatiques, comme notre oreille interne dont les os sont déjà présents, affectés à d'autres tâches, chez les poissons. La kératine de nos cheveux est une adaptation à la sécheresse qui date de la sortie des eaux des amphibiens, de même que le nez, bien plus développé que chez les grands singes, est une adaptation aux savanes poussiéreuses qu'arpentait notre ancêtre australopithèque il y a quelques millions d'années. » Alain Froment