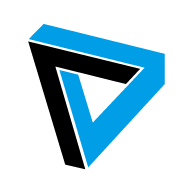Une prise de conscience

Pour que la Terre reste un monde vivable pour les générations futures. #6/8
La Terre en état d'alerte climatique
En octobre 2023, une équipe internationale de chercheurs dirigée par William Ripple de l'université d'État de l'Oregon a alerté sur l'état critique de la Terre dans un rapport publié dans la revue BioScience. Ce rapport fait suite à une série d'études similaires initiées en 2019, s'inscrivant dans un effort scientifique continu de surveillance des indicateurs climatiques planétaires. Le document, intitulé "The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory", met en lumière la contradiction frappante entre la prospérité matérielle croissante et la détérioration écologique accélérée de notre planète.
Une situation climatique sans précédent
La planète Terre traverse une crise climatique d'une ampleur inédite, caractérisée par des conditions météorologiques extrêmes et des records climatiques battus à un rythme alarmant. Les températures moyennes globales ont dépassé de 1,4°C les niveaux préindustriels en 2023, approchant dangereusement le seuil critique de 1,5°C établi par l'Accord de Paris. Les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre ont engendré des températures mondiales records, des océans historiquement chauds, une fonte des glaces sans précédent et des vagues de chaleur extrêmes touchant tous les continents.
Les scientifiques ont identifié 35 "signaux vitaux planétaires" - des indicateurs clés incluant les concentrations atmosphériques de CO2, l'acidification des océans, la fonte des calottes glaciaires, et la perte de biodiversité - parmi lesquels 20 atteignent aujourd'hui des niveaux records. Cette méthodologie, bien qu'adoptée par plusieurs équipes de recherche, peut présenter de légères variations dans le décompte selon les critères spécifiques retenus par chaque étude.
Des impacts multiples et interconnectés
Le rapport documente de manière exhaustive les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique mondiale, la perte accélérée de couverture forestière, ainsi que les effets dévastateurs sur les océans, les glaciers et les écosystèmes marins. L'année 2023 a été particulièrement marquée par des phénomènes El Niño exceptionnellement intenses, contribuant à amplifier les températures océaniques déjà en hausse structurelle. De nombreux records climatiques ont été pulvérisés "par d'énormes marges", notamment concernant les températures océaniques de surface et la réduction dramatique de l'étendue de la glace de mer antarctique.
Une saison d'incendies extraordinaire au Canada a généré des émissions de dioxyde de carbone sans précédent, libérant dans l'atmosphère l'équivalent de plusieurs années d'efforts de réduction d'émissions dans d'autres secteurs. Malgré certains progrès encourageants dans la réduction de la déforestation et l'expansion des énergies renouvelables, qui représentent désormais environ 30% de la production électrique mondiale, les émissions de carbone continuent leur progression inexorable, les combustibles fossiles maintenant leur emprise sur le bouquet énergétique mondial.
Un appel urgent à l'action
Les scientifiques soulignent que ces phénomènes constituent les signes avant-coureurs d'une instabilité climatique dangereuse, affirmant que "nous nous aventurons dans un territoire climatique inexploré". Cette formulation traduit le fait que les modèles climatiques actuels, malgré leur haute sophistication, atteignent leurs limites prédictives face à l'évolution du système terrestre dans des conditions aussi extrêmes. Le rapport met en évidence l'urgence d'une action immédiate et coordonnée pour lutter contre le changement climatique, qualifiant la situation actuelle de menace existentielle pour l'humanité.
Les chercheurs préconisent une transformation systémique incluant une décarbonation accélérée de l'économie, une protection renforcée des écosystèmes naturels, et une transition vers des modèles de développement plus durables. Ils appellent à une prise de conscience collective et à des actions politiques décisives pour atténuer les effets du changement climatique et préserver les conditions d'habitabilité de la planète pour les générations futures.
De la performance à la robustesse : repenser notre rapport au vivant
Les impasses de la société performante
Pour répondre aux besoins (en partie imaginaires) du citadin occidental du 20e siècle, l'adaptation de la Terre a été optimisée à l'extrême. De nouvelles propositions émergent chaque jour pour un mode de vie toujours plus déconnecté de la nature, avec une surenchère de nouveaux besoins alimentée par des outils connectés à Internet de plus en plus exigeants en ressources. Cette course à l'hyper-connexion et à la dématérialisation cache en réalité une matérialité croissante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le numérique représente déjà 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2025. En France, 10% de notre consommation électrique est liée au numérique. L'adaptation de la Terre à l'Homo numericus s'amplifie avec une foi inébranlable au détriment des écosystèmes.
Nous avons franchi ce que Johan Rockström nomme les "limites planétaires" : neuf seuils environnementaux critiques incluant le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, ou encore l'acidification des océans - des seuils à l'échelle mondiale à ne pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr. Paradoxalement, les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution servent parfois à justifier une production accrue de technologies prétendument salvatrices. Cette logique du "solutionnisme technologique" maintient l'illusion qu'on peut résoudre les problèmes créés par la technologie avec encore plus de technologie.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Apathiques, nous assistons à une compétition entre différentes formes de capitalisme - qu'il soit libéral, d'État ou vert (green capitalism) -, alors qu'il serait urgent de tourner le dos à ce modèle de croissance socio-économique basé sur la performance.
La robustesse comme alternative : les leçons du vivant
Pour envisager notre futur dans un monde fluctuant, le biologiste Olivier Hamant, directeur de recherche à l'INRAE et directeur de l'Institut Michel Serres, propose de sortir du culte de la performance en s'inspirant des principes de la nature et du vivant. Ses recherches sur la croissance et la forme des plantes l'ont conduit à identifier des principes fondamentaux : la circularité, la coopération et l'adaptabilité.
Mais qu'est-ce que la robustesse exactement ? Contrairement à la performance qui vise l'optimisation maximale d'un paramètre donné dans des conditions idéales et contrôlées, la robustesse privilégie la stabilité face aux perturbations et aux variations imprévisibles de l'environnement. Là où la performance recherche l'efficacité à court terme en simplifiant et spécialisant les systèmes, la robustesse construit la durabilité à long terme en maintenant la diversité et la redondance. Cette approche trouve ses racines dans l'observation du vivant : les écosystèmes les plus stables ne sont pas les plus "performants" mais les plus diversifiés et interconnectés. Par exemple, une forêt ancienne résiste mieux aux perturbations qu'une monoculture intensive, même si cette dernière peut produire plus à court terme.
Olivier Hamant propose donc la robustesse comme réponse opérationnelle aux turbulences sociales, financières, sanitaires, écologiques, énergétiques ou géopolitiques. Cette approche s'inspire directement de la biologie évolutive : les organismes qui survivent ne sont pas les plus forts ou les plus rapides, mais ceux qui s'adaptent le mieux aux changements. Passer d'une société performante à une société robuste constitue certes une révolution copernicienne, mais aussi une voie stimulante qui démine l'éco-anxiété grandissante face aux constats qui peuvent écraser.
Vers une mise en œuvre concrète
L'injonction de sobriété, souligne Olivier Hamant, n'est pas opérationnelle quand elle s'adresse sans discernement à une population qui n'a rien plutôt qu'à une population riche et privilégiée. Cette approche moralisatrice génère culpabilité et résistance sans s'attaquer aux véritables leviers structurels. Comme il l'explique : « si on commence par la robustesse et à techno-diversifier, on va devenir sobre, presque sans s'en rendre compte ».
Concrètement, cela signifie privilégier les circuits courts en agriculture, développer l'économie circulaire, favoriser la réparation plutôt que le remplacement, diversifier nos sources d'énergie et nos modèles économiques. Il s'agit de passer d'une logique de flux tendus et de just-in-time à une logique de résilience avec des stocks tampons et des alternatives multiples. Il ne s'agirait pas de renoncer à l'efficience ou à la sobriété, mais de ne les mettre en œuvre que dans le cadre de solutions robustes.
La robustesse se construit sur la circularité et la réutilisation matérielle, mais aussi sur la richesse des interactions et de la collaboration pour résoudre les problèmes. Au niveau territorial, cela implique de relocaliser certaines activités, de créer des réseaux d'entraide entre acteurs locaux, et de développer des compétences diversifiées au sein des communautés. Faire de la robustesse, c'est sortir de la pensée réductionniste qui valorise l'appauvrissement des interactions pour aller vers la pensée systémique qui se construit au contraire sur l'abondance des interactions.
"Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant" d'Olivier Hamant (Gallimard, 2023)

L'urgence d'un changement de paradigme
Malgré les obstacles, la véritable libération requiert un changement non seulement dans les structures tangibles de la société, mais aussi dans les idées, les croyances et les perspectives qui les sous-tendent. Nos représentations mentales, héritées des Lumières et de la révolution industrielle, nous font percevoir la nature comme un stock de ressources à exploiter plutôt que comme un système complexe dont nous faisons partie. Cela implique une remise en question des représentations et des modes de perception afin d'évoluer vers des alternatives plus équilibrées et durables.
Pour le dire avec les mots de l'historienne Barbara Duden : « Il (Ivan Illich) avait compris que ce n'est pas tant des techniques et des institutions qu'il faut nous libérer, mais des représentations et des modes de perception qu'elles génèrent ». Illich, penseur de l'écologie politique, avait anticipé dès les années 1970 comment nos outils finissent par nous asservir en créant de nouveaux besoins artificiels.
La transition écologique n'envisage pas encore de telles orientations politiques et sociétales. Et pour cause : le pays qui initierait des changements allant vers la décroissance deviendrait la cible immédiate des marchés financiers, surtout s'il est fortement endetté avec des capitaux étrangers. Cette contrainte géopolitique et financière constitue le principal verrou à une transformation écologique ambitieuse, créant un piège où chaque nation attend que les autres fassent le premier pas. Les citoyens restent souvent figés dans le statu quo, sans remise en question fondamentale des individus et des institutions qui les dirigent, avec un référentiel commun disloqué.
Pourtant, on attendrait des responsables politiques qu'ils rétablissent le contrôle sur l'avenir, au-delà des égoïsmes nationaux. Cela nécessiterait une gouvernance internationale renforcée et des mécanismes de coopération dépassant la logique concurrentielle actuelle. Quant aux scientifiques et aux ingénieurs, on attendrait d'eux qu'ils reprennent le contrôle sur leurs pratiques, en cherchant à travailler avec les processus naturels plutôt qu'à les remplacer. Cette biomimétique appliquée pourrait révolutionner nos approches technologiques, de l'architecture aux systèmes énergétiques.
Le pouvoir de l'imaginaire collectif
La construction d'imaginaires partagés et leur persistance sur plusieurs générations sont essentielles pour réaliser un futur positif dans notre société. L'histoire nous le montre : des récits visionnaires ont toujours précédé les grandes transformations humaines. Cyrano s'élève dans la Lune, Jules Verne et H.G. Wells l'ont décrochée.
Le rêve et l'utopie sont les enjeux premiers qui rendent demain possible. La conquête spatiale en témoigne : il a fallu rêver la Lune pendant des siècles avant que l'humanité ne pose effectivement le pied sur son sol. Les œuvres visionnaires, de Cyrano de Bergerac à Jules Verne, en passant par les romans de science-fiction du 20e siècle, ont nourri l'imaginaire collectif qui a rendu possible l'aventure spatiale. De même, les dystopies d'Orwell ou d'Huxley nous ont alertés sur les dérives totalitaires possibles, façonnant notre vigilance démocratique.
De même, imaginer et raconter une société "robuste, collaborative et en harmonie avec le vivant" constitue un préalable indispensable à sa réalisation. Il nous manque aujourd'hui des récits positifs et désirables d'un futur post-croissance, des "solarpunk" capables de mobiliser l'énergie collective vers cette transformation.
Il s'agit désormais de renier le credo de la performance et de réinsérer la technosphère dans le cycle du vivant.
« La nature menacée devient menaçante : notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Il va maintenant falloir vivre dans un monde fluctuant, c’est-à-dire inventer la civilisation de la robustesse, contre la performance. » Olivier Hamant.
Pour une autre Terre - suite #7/8 :