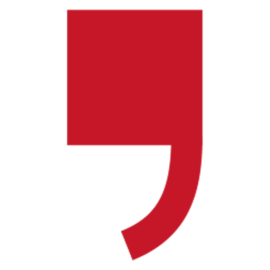Construire la ville de demain

Entre nécessités écologiques, innovations sociales et choix politiques
Les villes du futur ne relèvent plus de la science-fiction : elles sont désormais une réalité qui se dessine sous nos yeux. Des métropoles comme Madrid, Dubaï, Nairobi, Medellín, Helsinki, Tokyo, Séoul, Singapour ou Bangalore se positionnent à l'avant-garde de l'innovation. Les gratte-ciel vertigineux de Dubaï, les téléphériques urbains de Medellín, le quartier du design d'Helsinki, l'effervescence de Tokyo et Séoul, l'engagement singapourien pour la propreté et le bien commun, ou encore l'écosystème technologique de Bangalore avec ses 500 start-up offrent aux visiteurs un aperçu concret du futur.
Cependant, cette croissance rapide n'est pas sans conséquences. Les sols ont été bétonnés sans mise en place suffisante de systèmes de drainage, de canalisation et de récupération des eaux pluviales. À Bangalore, les précipitations ruissellent sur la ville sans alimenter les réserves hydriques. Faute de gestion publique adéquate, les fournisseurs privés creusent des puits toujours plus profonds et éloignés. À Dubaï, les inondations exceptionnelles du 16 avril 2024 ont marqué un tournant. Le gouvernement local a annoncé un plan de 7 milliards d'euros pour construire un système complet d'évacuation des eaux pluviales, selon Interesting Engineering (25 juin 2024).
En France, le printemps 2024 a été le 4e plus pluvieux depuis 1959, questionnant le lien entre précipitations et changement climatique. Aucune tendance nette ne se dégage pourtant à l'échelle nationale concernant l'évolution des précipitations annuelles. À une échelle plus fine, on observe néanmoins une augmentation des pluies hivernales dans le nord du pays et une diminution estivale dans le sud. Le Sud-Est français fait désormais face à des phénomènes climatiques comparables à ceux de l'Inde ou du Pakistan, témoignant de l'émergence d'une véritable mousson méditerranéenne. Ce phénomène inédit se traduit par des tempêtes explosives de type tropical. Dans l'Atlantique Nord, ces tempêtes gagneront en intensité, affectant particulièrement l'Espagne, les îles Britanniques, la France et la Scandinavie. Si les précipitations augmenteront au nord de l'Europe, le bassin méditerranéen s'aridifiera. D'ici 2100, les projections n'indiquent pas de tendance claire pour les précipitations annuelles, mais révèlent des disparités saisonnières et régionales accrues.
Ces exemples révèlent un paradoxe : alors que certaines villes s'érigent en vitrines technologiques, elles restent profondément vulnérables aux défis climatiques. Cette contradiction témoigne d'un modèle urbain en crise, tiraillé entre aspiration à l'innovation et persistance de logiques de développement obsolètes. C'est dans ce contexte que s'impose la nécessité de repenser fondamentalement nos manières de concevoir, d'organiser et d'habiter la ville.
I. La ville contemporaine, un territoire sous tension
A. L'urbanisme hérité face à l'impératif écologique
Nos villes ont été bâties sur des logiques productivistes et extractives qui considèrent l'espace urbain comme une ressource à exploiter et à rentabiliser. Cette approche s'est traduite par une artificialisation massive des sols, une consommation intensive de matériaux et d'énergie, ainsi qu'une externalisation systématique des coûts environnementaux. Les villes sont devenues des pôles de concentration des richesses et des activités économiques, aspirant les ressources des territoires environnants - eau, énergie, matières premières, main-d'œuvre - tout en rejetant leurs déchets et pollutions vers l'extérieur de leurs frontières administratives.
L'étalement urbain, hérité du modèle moderniste (Le Corbusier, la Charte d'Athènes), a fragmenté l'espace et généré une forte dépendance à la voiture. Cette logique de zonage fonctionnel - séparer l'habitat, le travail, les loisirs, les commerces - a créé des distances toujours plus importantes entre les activités quotidiennes, nécessitant des infrastructures de transport énergivores et polluantes. Or, face à l'urgence climatique et à l'épuisement des ressources, ce modèle devient insoutenable.
Les travaux de Françoise Fromonot ou Thierry Paquot critiquent la standardisation des formes urbaines et appellent à repenser la densité, la mixité et la nature en ville. L'urbanisme régénératif émerge ainsi comme une alternative, visant non seulement à réduire les dommages, mais à réparer les milieux vivants.
« L'enjeu n'est plus seulement de limiter l'impact de la ville sur l'environnement, mais de lui permettre de redevenir un écosystème habitable. » – Thierry Paquot

Transformer les métropoles européennes
En Europe, la transformation des métropoles les plus attractives passe par la revalorisation des quartiers, la revitalisation des espaces publics et l'intégration de technologies novatrices dans les infrastructures urbaines. Ce processus inclut la restauration de bâtiments patrimoniaux, l'aménagement de zones vertes, la conception de rues-jardins, la reconversion de friches industrielles et la promotion de l'agriculture urbaine.
L'innovation architecturale favorise des transformations profondes et collectives (en France, avec les écoquartiers de Clichy-Batignolles et La Courrouze à Rennes), mais la sobriété pourrait bien en être l'élément clé encore manquant.
Promouvoir l'économie circulaire et soutenir les structures locales d'échange permettent de réduire l'impact environnemental et d'optimiser l'utilisation des ressources. Les espaces collaboratifs tels que les fermes urbaines, fablabs, écoles ou ateliers favorisent la proximité et le partage de compétences.
Pour les partisans de la digitalisation, la ville intelligente représente l'avenir urbain. Des capteurs, des caméras et d'autres technologies connectées assurent une gestion plus fluide des flux, de la sécurité et du trafic. Cependant, l'avenir urbain ne se limite pas aux progrès technologiques. Il repose aussi sur la flexibilité des espaces, le renforcement des liens sociaux et la diversification des usages. Comme l'explique Sénamé Koffi Agbodjinou, architecte et anthropologue togolais : « La monofonctionnalité, c'est comme la monoculture : à un moment donné, ça assèche, ça détruit la biodiversité. »
B. Inégalités territoriales et fractures sociales
Henri Lefebvre, dans Le droit à la ville (1968), dénonçait déjà la domination de la logique marchande sur la fabrique urbaine. Aujourd'hui encore, la gentrification, la ségrégation résidentielle et les "quartiers oubliés" traduisent une inégale distribution de l'espace urbain.
Loïc Wacquant a analysé la marginalisation des périphéries dans une ville duale, où la centralité devient un privilège. L'accès aux ressources (transports, écoles, soins) dépend plus que jamais du lieu où l'on habite, ce qui accentue les inégalités structurelles.
L'opposition ville-campagne dépassée en France
L'opposition traditionnelle entre villes et campagnes apparaît dépassée. Les mobilités quotidiennes, le développement du numérique, la périurbanisation et l'étalement urbain ont contribué à tisser des continuités entre les mondes urbain et rural. Les travaux de Martin Vanier ou de Jacques Lévy insistent sur la nécessité de penser l'espace non plus en termes de dichotomie, mais d'interdépendance.
Cette reconfiguration brouille les catégories établies : la campagne est traversée par des dynamiques urbaines, tandis que la ville cherche à se "ruraliser" en réintégrant la nature, l'agriculture urbaine, les circuits courts. Le télétravail, accéléré par la crise sanitaire, a encore accentué ce brouillage.
« En 2024, il semble que l'État n'ait toujours pas intégré le basculement culturel qui est en cours. Les métropoles ne sont plus attractives. Chaque année, 700 000 personnes quittent les grandes villes, 200 000 pour la seule Île-de-France, et, en dix ans, Paris a perdu 120 000 habitants. À l'inverse, les territoires ruraux, les petites villes et villes moyennes attirent, et de plus en plus. » Christophe Guilluy, in : https://www.marianne.net/agora/humeurs/christophe-guilluy-les-robots-de-la-technostructure-ont-une-vision-claire-de-lavenir-de-la-france-peripherique
C. Le pouvoir d'organiser la ville : entre technocratie et citoyenneté
La fabrique de la ville reste un espace de pouvoir. Manuel Castells, en analysant les mouvements sociaux urbains, montre que les habitants peuvent être acteurs de leur territoire, mais que cela suppose des formes de démocratie active.
L'urbanisme "top-down" (technocratique) tend à négliger les savoirs d'usage, alors que les approches participatives (ateliers d'urbanisme, budgets participatifs) cherchent à rendre la décision plus horizontale.
C.1 -La fabrique démocratique de la ville
La ville n'est jamais un simple agencement de bâtiments, mais aussi, fondamentalement, un projet politique. Depuis plusieurs décennies, la fabrique urbaine est largement dominée par des logiques descendantes, technocratiques ou financières. Les habitants sont trop souvent réduits à de simples "usagers", "consultés" une fois les grandes décisions prises.
Le droit à la ville, tel que formulé par Henri Lefebvre, ne se limite pas au droit d'accéder à l'espace urbain : il implique le droit de le produire collectivement, de participer aux choix qui façonnent son évolution.
Plusieurs leviers peuvent contribuer à une repolitisation de la fabrique urbaine :
- Replacer les habitants au cœur du processus : aller au-delà de la simple "concertation" pour inventer de véritables formes de co-conception, de gouvernance partagée, de budgets participatifs territorialisés.
- Reconnaître la diversité des savoirs : les expertises d'usage, les connaissances habitantes, les pratiques informelles enrichissent la compréhension du territoire.
- Dépasser le modèle de la commande descendante : accompagner les initiatives locales, soutenir les communs urbains, favoriser l'émergence de lieux auto-gérés.
- Interroger le rôle du privé dans la production urbaine : la montée en puissance des grands groupes immobiliers et des plateformes numériques pose la question du contrôle démocratique sur l'espace commun.
Confrontée à des tensions structurelles qui traversent la ville contemporaine, la pensée urbaine voit émerger de nouvelles approches visant à réinventer l’urbain. Plutôt que de nier les contradictions héritées, ces innovations cherchent à les transformer en leviers de transition vers des modèles plus durables, inclusifs et démocratiques.
C.2 - L'urbanisme comme acte de pouvoir : les enjeux de la décision
Pour Jean-Paul Lacaze, ingénieur et théoricien de l'urbanisme, la seule chose qui distingue l'urbanisme de la géographie urbaine, c'est précisément l'existence d'une volonté d'agir et donc d'exercer un pouvoir. Cette dimension politique de l'urbanisme, souvent occultée par les discours techniques, constitue pourtant le cœur de la pratique urbanistique.
L'urbanisme naît à partir du moment où quelqu'un estime nécessaire de provoquer une action pour transformer les modes d'utilisation de l'espace. Cette volonté d'action soulève immédiatement la question centrale : qui peut valablement décider qu'une situation est préférable à une autre, et selon quels critères ? Car les actes d'urbanisme sont profondément inégalitaires : délimiter des zones urbanisables favorise certains propriétaires au détriment d'autres, distinguer les immeubles à détruire de ceux à rénover crée des gagnants et des perdants.
Face à cette réalité, il n'existe pas de méthode rationnelle d'optimisation des choix. Les notions d'intérêt général ou d'optimum technico-économique véhiculent plus d'idéologies implicites que de rationalité réelle. Il n'y a pas de commune mesure entre les avantages que reçoivent certains citoyens et les inconvénients que d'autres doivent subir. La décision ne peut relever que d'un arbitrage politique, non d'une méthode prétendument objective.
Cette analyse révèle l'importance cruciale du mode de décision en urbanisme. Un aménagement arrêté après une longue procédure participative ne sera pas nécessairement différent de celui qui aurait pu être commandé directement à un expert. S'il est jugé préférable, c'est parce que le processus de décision a permis aux citoyens concernés de s'approprier progressivement le projet. Le processus participatif opère un renversement fondamental : il substitue des valeurs d'usage vernaculaire - liées aux pratiques quotidiennes et aux micro-ritualisations de l'espace - aux valeurs abstraites d'esthétique, d'efficacité technique ou de conformité administrative.
L'urbanisme contemporain dispose ainsi d'une véritable "boîte à outils" méthodologique, où coexistent différentes approches selon la nature des problèmes à traiter : planification stratégique pour modifier les structures urbaines, composition urbaine pour créer de nouveaux quartiers, urbanisme participatif pour améliorer la vie quotidienne, urbanisme de gestion pour optimiser les services existants, ou encore urbanisme de communication pour valoriser l'image urbaine. Chaque méthode correspond à des valeurs de référence, des modes de décision et des champs professionnels spécifiques.
La professionnalisation de l'urbanisme consiste précisément à savoir choisir le mode de décision adapté à chaque situation. Cette capacité d'analyse et d'adaptation méthodologique s'avère plus importante que le contenu technique des décisions elles-mêmes. Elle suppose une lucidité face aux phénomènes de pouvoir qui traversent toute intervention urbaine, condition nécessaire pour éviter les dérives technocratiques et construire une pratique démocratique de l'urbanisme.
Le texte suivant est à télécharger :
II. Repenser la ville : approches et innovations contemporaines
A. La "ville du quart d'heure" et la chronotopie urbaine
Concept popularisé par Carlos Moreno, la ville du quart d'heure vise à rapprocher les fonctions essentielles (travailler, se soigner, consommer, se cultiver, se détendre). Cette approche repose sur une lecture chronotopique de la ville – croiser l'espace et le temps urbain.
Inspirée de la pensée de Jane Jacobs (la ville vivante, à échelle humaine), elle vise une intensification douce de la ville. On revient ainsi à une logique de centralités multiples, réduisant la dépendance à la voiture et favorisant les mobilités actives.

La chronotopie : optimiser l'espace-temps
La chronotopie est une pratique qui prend en compte à la fois les dimensions temporelles (chronos) et spatiales (topos) pour penser l'espace en fonction du temps disponible et des usages possibles. Elle permet de repenser les lieux en mutualisant les besoins ou en hybridant les usages :
- Mutualiser les espaces : optimiser l'utilisation pour un même usage avec différents profils d'utilisateurs (parking de ville utilisé par les résidents la nuit et par les salariés le jour).
- Hybrider les usages : adapter un même espace à d'autres besoins que son besoin primaire (restaurant d'entreprise servant de lieu de rassemblement en dehors des plages de repas).
« Penser la ville et les bâtiments comme des salles polyvalentes. » – Benjamin Pradel
In : https://fairspace.fr/amenagement/chronotopie-tendance-en-fort-developpement/

Les six besoins de la ville du quart d'heure
Selon Carlos Moreno, il y a six besoins qu'on devrait retrouver à un quart d'heure de chez soi : habiter dans des conditions dignes, travailler, s'éduquer, se soigner, s'approvisionner et s'épanouir. S'épanouir, c'est profiter de l'espace public avec de l'air, de l'eau, de la végétalisation, avec le moins de pollution possible.

En France, environ 80% de la voirie est réservée à la voiture, incluant les espaces de circulation et de stationnement, bien que les voitures ne soient utilisées que 10% du temps. Cela montre une utilisation disproportionnée de l'espace public par les véhicules.
B. Architecture et design urbain comme leviers de transition
L'architecture contemporaine est appelée à devenir résiliente et contextuelle. Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal, lauréats du prix Pritzker, plaident pour le "faire avec" : transformer plutôt que détruire, ajouter plutôt que remplacer.
La conception des espaces publics devient centrale : Jan Gehl, urbaniste danois, invite à penser la ville "pour les gens, pas pour les voitures". Cela suppose des formes sobres, évolutives, réversibles.
« L'ambition affichée de pays d'être à la pointe du développement urbain durable à travers des projets pilotes ne doit pas faire oublier que le plus grand enjeu est la ville existante. C'est la reconstruction de la ville sur la ville. » – Nicolas Samsoen
Point de vue :

Point de vue
Le rôle de l'architecture : réenchanter l'espace

« Un bon bâtiment redéfinit un lieu. Un bon bâtiment apporte une nouvelle vision. Il offre également du confort mais, en même temps, il remet en question nos attentes. C'est un bâtiment qui intègre l'innovation culturelle, sociale et technologique. Et c'est un type de bâtiment qui peut être adapté, transformé ou entièrement changé dans le futur sans perdre ses caractéristiques propres. » – Jürgen Mayer H.
L'architecture ne peut plus être pensée comme l'art de bâtir de beaux objets autonomes. Elle devient un vecteur de transformation urbaine, un acteur culturel, un instrument politique. Face aux défis contemporains, cette approche suppose un profond renouvellement des pratiques architecturales :
- Une architecture sobre, contextuelle, réversible : la transition écologique impose de rompre avec l'architecture spectaculaire, gourmande en ressources. L'heure est à la sobriété constructive, à l'attention portée aux matériaux biosourcés, à la modularité.
- Une architecture habitée, inclusive, ouverte au commun : le confort inclut la possibilité d'appropriation, de liberté d'usage, de coexistence. L'architecture devient un outil de justice spatiale.
- Une architecture porteuse de récits et de temporalités : le bâtiment peut être un nœud de mémoire, un marqueur symbolique, un récit inscrit dans la matière.
C. Technologies au service de la ville ou outils de contrôle ?
La "smart city" repose sur l'idée d'une ville optimisée par la donnée. Mais Evgeny Morozov dénonce la tentation du solutionnisme technologique, qui fait de chaque problème un objet de gestion algorithmique.
La donnée urbaine peut améliorer la gestion de l'énergie ou du trafic, mais elle pose aussi des questions de gouvernance : à qui appartiennent les données ? Comment éviter la surveillance généralisée ?
Smart city : entre promesses et critiques
Cette approche suscite des critiques. Evgeny Morozov met en garde contre le "solutionnisme technologique" qui repose sur l'illusion que toute difficulté urbaine pourrait être résolue par une bonne couche d'algorithmique. Cette réduction des problèmes à des flux de données invisibilise les causes profondes, politiques ou structurelles, des dysfonctionnements urbains.
Le risque est celui d'une ville gouvernée par des logiques d'ingénierie, où la technologie devient l'alpha et l'oméga de toute décision. La smart city, loin d'être une utopie partagée, pourrait devenir une forme douce mais insidieuse de technocratie.
Si la ville intelligente veut réellement être au service de ses citoyens, elle ne peut se contenter d'être une ville instrumentée : elle doit être aussi une ville politique, c'est-à-dire capable de débattre des finalités collectives que servent les technologies, au lieu de se laisser dicter l'agenda par elles.
D. Les conditions de la transition : financement, gouvernance et temporalités
Les innovations urbaines, aussi prometteuses soient-elles, se heurtent à des défis structurels qui conditionnent leur mise en œuvre effective. La transition vers des villes plus durables et inclusives ne peut faire l'économie d'une réflexion sur ses conditions matérielles et politiques.
Le défi du financement
La transformation urbaine représente des investissements considérables. Les écoquartiers, les infrastructures de mobilité douce, la rénovation énergétique des bâtiments, le déploiement des technologies numériques : autant de projets qui nécessitent des moyens financiers importants et durables.
Les collectivités locales, souvent contraintes par des budgets serrés, peinent à porter seules ces ambitions. Se pose alors la question des modèles de financement : partenariats public-privé, fonds européens, fiscalité locale, mécanismes d'investissement participatif. Comment éviter que les impératifs de rentabilité à court terme ne viennent dénaturer les projets ? Comment garantir que l'intérêt général prime sur les logiques spéculatives ?
Gouvernance multi-niveaux et coopération territoriale
La ville ne se transforme pas dans l'isolement. Elle s'inscrit dans des réseaux d'interdépendance qui dépassent ses frontières administratives : bassin d'emploi, aire urbaine, région, nation, Europe. Les politiques urbaines doivent donc articuler différentes échelles d'action et faire dialoguer des acteurs aux logiques parfois divergentes.
Cette gouvernance multi-niveaux suppose de nouvelles formes de coopération entre territoires. Les métropoles ne peuvent plus ignorer leurs périphéries, les villes moyennes doivent trouver leur place dans les réseaux urbains, les territoires ruraux ont un rôle à jouer dans la transition écologique. C'est tout l'enjeu des schémas de cohérence territoriale, des contrats de réciprocité ville-campagne, ou encore des coopérations interrégionales.
Les temporalités de la transition
La transformation urbaine s'inscrit dans des temporalités multiples et parfois contradictoires. Le temps politique (mandats électoraux, échéances budgétaires) ne coïncide pas nécessairement avec le temps de la planification urbaine (20-30 ans) ou celui de l'urgence climatique.
Cette tension temporelle appelle une double exigence : d'une part, des actions immédiates et visibles pour répondre aux attentes citoyennes et démontrer la faisabilité du changement (urbanisme tactique, expérimentations locales) ; d'autre part, une vision de long terme capable de résister aux alternances politiques et de maintenir le cap malgré les résistances.
Les villes qui réussissent leur transition sont souvent celles qui parviennent à articuler ces différents temps : expérimenter rapidement, évaluer, ajuster, puis déployer à plus grande échelle. Elles cultivent une culture de l'adaptation continue plutôt que de la planification rigide.
Dépasser les résistances au changement
Toute transformation urbaine génère des résistances : habitudes de mobilité, intérêts économiques établis, peurs du changement, inégalités d'accès aux innovations. Ces résistances ne sont pas seulement des obstacles techniques, mais révèlent souvent des fractures sociales ou des déficits démocratiques.
L'acceptabilité sociale des transitions urbaines suppose donc un travail patient de pédagogie, de co-construction, d'accompagnement des populations les plus vulnérables. Elle implique aussi de reconnaître que certaines innovations peuvent avoir des effets d'exclusion (gentrification verte, fracture numérique) et d'anticiper des mesures correctrices.
Ces conditions de la transition ne sont pas de simples contraintes techniques : elles révèlent les enjeux politiques profonds de la transformation urbaine. Une ville qui se contenterait d'innovations spectaculaires sans interroger leurs conditions de possibilité risquerait de reproduire, sous des formes nouvelles, les inégalités et les exclusions qu'elle prétend combattre.
C'est en prenant au sérieux ces défis - financiers, démocratiques, temporels - que les innovations urbaines peuvent véritablement ouvrir la voie à une vision plus ambitieuse : celle d'une ville qui ne se contente plus de gérer les crises, mais qui anticipe, s'adapte et se transforme pour devenir résiliente, solidaire et désirable.
III. Vers une ville résiliente, solidaire et désirable
A. La résilience climatique comme cadre d'action
Face aux chocs (canicules, inondations, crises sanitaires), la ville doit devenir résiliente. Cela implique une anticipation systémique : l'urbanisme tactique (interventions rapides, réversibles) ou les infrastructures vertes (trames bleues et vertes, zones d'expansion des crues) sont des réponses souples à des menaces structurelles.

https://www.aurba.org/wp-content/uploads/2020/10/aurbaAEP_urbanisme-tactique.pdf


B. Repenser les mobilités pour une ville accessible
Les mobilités douces (marche, vélo), intermodales et inclusives sont au cœur d'un urbanisme post-carbone. Frédéric Héran, dans Le retour de la bicyclette, insiste sur les bénéfices sociaux, sanitaires et économiques d'une ville moins dépendante de la voiture.
Vers un urbanisme post-carbone et inclusif
La question des mobilités touche à l'accès aux droits, à la structuration de l'espace, à l'inclusion sociale et à la soutenabilité environnementale. Pendant des décennies, l'organisation urbaine a été modelée par la voiture individuelle, engendrant un urbanisme de la séparation et un allongement des distances.
Face à cela, émerge un paradigme de la proximité et de la diversité modale. La marche, le vélo, les transports en commun, les services de mobilité partagée constituent les piliers d'un urbanisme post-carbone. Mais pour que cette transition soit juste, elle doit intégrer la dimension sociale de la mobilité.
La mobilité devient un révélateur de justice spatiale : pouvoir se déplacer, c'est pouvoir accéder – à l'emploi, à la santé, à la culture, à la participation démocratique.
C. Une utopie concrète : pluralité des modèles urbains
Plutôt que chercher une "ville idéale", il s'agit d'imaginer des modèles contextuels, adaptés aux usages, aux cultures locales, aux écosystèmes. Les "villes lentes" (Cittaslow), les écoquartiers coopératifs (Fribourg-en-Brisgau, Vauban), ou encore les tiers-lieux urbains offrent des pistes.
Architecture et participation : vers une ville habitée
L'architecture participative fait de l'acte de construire un processus collectif, un temps de dialogue et d'apprentissage. Elle revalorise les savoirs profanes, les pratiques habitantes, les gestes d'usage.
L'autoconstruction permet de désacraliser l'acte de construire, de le ramener au niveau du collectif. La co-conception engage une posture d'humilité et d'ouverture de la part des architectes. Les tiers-lieux incarnent cette hybridation entre architecture, société et projet collectif.
Penser l'urbain comme un continuum territorial
La notion de continuum territorial invite à dépasser les catégories rigides de "ville", "périphérie" et "campagne", pour envisager l'espace habité comme un système fluide, interconnecté, évolutif. Il s'agit d'entrer dans une logique de co-dépendance active, où les fonctions sont réparties, mutualisées, coordonnées.
Cela implique un changement de perspective dans les politiques d'aménagement : ne plus penser uniquement en termes de polarités économiques, mais réinvestir l'échelle intermédiaire, celle des bassins de vie, des territoires de proximité.
« L'architecture existe parce que nous croyons en un avenir meilleur »
Architecture et utopies : l'exemple africain
Pour l'architecte togolais Sénamé Koffi Agbodjinou, il est urgent pour l'Afrique d'affirmer un modèle urbain qui lui permette de renouer avec ses racines, mais en modernité. Son projet "Hubcité" encourage les habitants d'un quartier de Lomé à développer des start-up numériques pour améliorer leur communauté.
Son idéal de "ville néovernaculaire africaine" mêle traditions locales et innovation digitale pour une ville plus intelligente, durable et démocratique.
« Il faut penser un nouveau schéma de cité qui ne fasse pas violence à la ruralité, car cette dernière est constitutive de la personnalité africaine et de notre conception de la société. » – Sénamé Koffi Agbodjinou

Conclusion
Le futur des villes ne saurait être l'affaire exclusive des urbanistes, des ingénieurs ou des décideurs. Il engage une vision collective du monde à venir, où se croisent nos manières d'habiter, de circuler, de travailler, mais aussi de vivre ensemble.
Ce futur urbain ne pourra être qu'un futur pluriel, évolutif, à l'écoute des territoires et de leurs habitants. Ni nostalgie des centres historiques, ni fascination pour les promesses lisses de la smart city : il s'agit de construire un urbanisme du vivant, une ville poreuse aux imaginaires, mais ancrée dans le réel.
Préparer la ville de demain, c'est refuser qu'elle soit un objet figé, planifié selon une seule logique, pour en faire un projet collectif, une œuvre en mouvement, attentive aux rythmes de la vie autant qu'aux grands enjeux de notre temps.
Sources et Références pour "Construire la ville de demain"
Sources et références
Auteurs et concepts clés mentionnés dans l'article :
- Thierry Paquot - Philosophe de l'urbain, critique de la standardisation urbaine et défenseur d'un urbanisme régénératif
- Françoise Fromonot - Architecte et critique, spécialiste de l'architecture contemporaine et de la transformation urbaine
- Henri Lefebvre - Le Droit à la ville (1968) - Concept fondamental du droit à produire collectivement l'espace urbain
- Loïc Wacquant - Sociologue, analyste de la marginalisation urbaine et de la ville duale
- Martin Vanier - Géographe, spécialiste des relations ville-campagne et de l'interdépendance territoriale
- Jacques Lévy - Géographe, théoricien de l'espace et des mobilités urbaines
- Manuel Castells - Sociologue urbain, analyste des mouvements sociaux urbains et de la démocratie participative
- Carlos Moreno - Urbaniste, concepteur de la "ville du quart d'heure"
- Jane Jacobs - Théoricienne urbaine, défenseure de la ville vivante à échelle humaine
- Benjamin Pradel - Spécialiste de la chronotopie urbaine et de l'optimisation espace-temps
- Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal - Architectes, prix Pritzker, défenseurs du "faire avec" plutôt que détruire
- Jan Gehl - Urbaniste danois, promoteur de la ville "pour les gens, pas pour les voitures"
- Nicolas Samsoen - Architecte, spécialiste de l'urbanisme durable et de la reconstruction sur la ville existante
- Jürgen Mayer H. - Architecte, théoricien de l'architecture adaptative et transformative
- Evgeny Morozov - Critique du solutionnisme technologique et de la smart city
- Frédéric Héran - Le Retour de la bicyclette - Spécialiste des mobilités douces et de l'urbanisme post-carbone
- Sénamé Koffi Agbodjinou - Architecte et anthropologue togolais, concepteur de la "ville néovernaculaire africaine" et du projet "Hubcité"
- Jean-Paul Lacaze - Ingénieur et théoricien de l'urbanisme, analyse de l'urbanisme comme acte de pouvoir et typologie des méthodes urbanistiques
- Christophe Guilluy - Géographe, analyste des fractures territoriales et de l'exode urbain vers les territoires périphériques
Exemples de villes et projets mentionnés :
- Villes innovantes : Madrid, Dubaï, Nairobi, Medellin, Helsinki, Tokyo, Séoul, Singapour, Bangalore
- Écoquartiers français : Clichy-Batignolles (Paris), La Courrouze (Rennes)
- Modèles urbains : Cittaslow (villes lentes), Fribourg-en-Brisgau (quartier Vauban)
- Hubcité (Lomé, Togo)
Concepts théoriques développés :
- Urbanisme régénératif vs. urbanisme extractif
- Ville du quart d'heure et chronotopie urbaine
- Droit à la ville et démocratie participative
- Continuum territorial ville-campagne
- Architecture participative et savoirs d'usage
- Smart city vs. solutionnisme technologique
- Mobilités douces et urbanisme post-carbone
- Résilience climatique et infrastructures vertes
Annexes : Un futur pluriel


Découvrez comment les termites ont inspiré un bâtiment capable de se refroidir lui-même.
Naço Architectures développe un projet innovant fusionnant architecture et art grâce à l'intelligence artificielle générative. En s'appuyant sur les œuvres de grands architectes et artistes, l'IA génère des designs hybrides qui transcendent les frontières traditionnelles entre forme et fonction. Cette approche explore les nouvelles possibilités créatives offertes par la technologie pour repenser l'avenir de l'architecture.

Projet ZERO - HYBRIDATION
À l’Arsenal, une expo charabia pour vraiment prendre soin de la planète…

« Que des architectes réfléchissent et créent des prototypes, c’est tant mieux et une preuve de curiosité mais qu’ils cessent de justifier chacun de leurs travaux au nom du sauvetage de la planète. Si c’est bien leur intention, face aux enjeux qui se profilent, le sens des proportions s’impose et la modestie est un bon début ». Christophe Leray