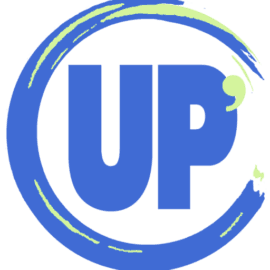Que nous apprend la SF ?

« La science-fiction a d’abord un rôle d’alerte ». Yannick Rumpala
Roland Lehoucq, astrophysicien et président des Utopiales, met en avant l'importance de la science-fiction pour comprendre les enjeux contemporains, notamment technologiques et écologiques. Il explique comment il concilie son travail de chercheur avec sa passion pour la science-fiction et la vulgarisation scientifique.

Les sciences permettent de comprendre le réel, et leurs sous-produits techniques modifient les sociétés humaines et leurs interactions avec leur environnement. En tant qu’unique littérature qui intègre explicitement les sciences et les techniques pour en envisager les conséquences sur l’humanité, la science-fiction est l’un des moyens de décrypter le présent pour éviter la catastrophe qui s’annonce.
Ce que la science-fiction pourrait apprendre à la French Tech.
À travers Dune de Frank Herbert, Roland Lehoucq aborde des thèmes comme la souveraineté technologique et le rapport critique à l'innovation. La science-fiction, selon lui, offre des perspectives originales pour repenser nos modèles économiques, sociaux et politiques, tout en ouvrant la voie à des récits optimistes tels que le "hopepunk" et le "solarpunk". Elle incite à privilégier une "right tech", adaptée à nos besoins réels, et à imaginer des futurs souhaitables, nécessaires face aux défis climatiques et sociétaux.

« La science-fiction peut contribuer à modifier nos imaginaires et nous défaire de celui qui prône l’extraction, la production et la consommation de ressources à outrance ».
Roland Lehoucq est l'auteur de « Dune – Enquête scientifique et culturelle sur une planète-univers ».

« Que se passerait-il SI ? »
Peter Watts, ancien biologiste marin devenu écrivain de science-fiction, évoque dans ce bref entretien les liens entre science et SF, et explique pourquoi il porte sur l’avenir un regard à la fois optimiste et pessimiste.

La SF, une expérience de pensée mise au service du présent.
Un entretien passionnant avec Romain Lucazeau, l'auteur du diptyque Latium et de La Nuit du faune, entre autres œuvres marquantes.

A l'occasion de la sortie de "Dune 2" : que nous apprend la science-fiction ?
L’adaptation par Denis Villeneuve du roman de Franck Herbert porte sur les écrans de cinéma la menace de la crise écologique, le populisme ou encore le messianisme religieux.

D'autres ont déjà opté pour nous d'une destination.
Une émission avec :
- Catherine Dufour, écrivaine de science-fiction et ingénieure informatique, autrice du roman "Les Champs de la Lune" sorti en 2024.
- Lloyd Chéry, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, directeur de l'ouvrage "Tout sur Dune" paru en 2021 chez L'Atalante.
- Ariel Kyrou, écrivain et philosophe, auteur de l'essai “Dans les imaginaires du futur” publié chez ActuSF en 2020.
Hollywood et le Pentagone : Une alliance stratégique.
Après Dune, restons dans le domaine du cinéma avec un ouvrage qui cherche à démontrer l'interdépendance entre Hollywood, le Pentagone et la Maison-Blanche.
Hollywood et le Pentagone : d'un côté, une grande industrie, « faiseurs de rêves », de l'autre, le ministère de la Défense américain. Quelles relations unissent ces deux puissants symboles de la puissance américaine ? Cette analyse approfondie des films grand public hollywoodiens lève le voile sur l'interdépendance entre ces deux institutions. L'industrie cinématographique est exposée comme un acteur clé du débat stratégique américain à travers la production de films sur la sécurité nationale dans de nombreux genres, de la comédie au thriller, de la science-fiction au film de guerre. Ce livre opportun explore également les idées dominantes sur la « menace » que représente pour le territoire américain la « chaîne de sécurité nationale », une menace qui est considérée comme la justification et la légitimation des opérations militaires et des choix stratégiques américains.
Ce livre révèle comment, au cours des vingt dernières années, il y a eu une collaboration constante entre ces deux industries : d'énormes contrats ont été échangés entre les studios et le ministère de la Défense. Il montre comment Hollywood est complètement imprégné par la pensée idéologique et politique de Washington, qui à son tour semble être directement inspirée par les productions hollywoodiennes.
À propos de l'auteur : Jean-Michel Valantin est maître de conférences en études stratégiques et sociologie de la défense, spécialiste de la stratégie américaine et chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire sur la paix et les études stratégiques (CIRPES).
Pour en savoir plus sur ce livre :
Kac-Vergne Marianne - Politique étrangère Année 2003 68-3-4 pp. 856-857

Gérald Arboit, « Jean-Michel Valantin, Hollywood, le Pentagone et Washington. Les trois acteurs d’une stratégie globale », Questions de communication [En ligne], 5 | 2004, mis en ligne le 19 juillet 2013, consulté le 03 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7165 ; DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.7165

Peut-on faire de la science-fiction, un « mode de connaissance du futur » ?
Dans un environnement complexe et incertain, la capacité d'anticiper, de se préparer aux chocs et aux ruptures à venir est un atout majeur pour les individus et pour les organisations. Une discipline, permettant de se préparer à l'avenir**,** s'est développée dans les années 1930 aux États-Unis : la prospective.
Dans les années 1930, lorsque Roosevelt décide que pour remédier à la crise, l'État fédéral doit intervenir dans les domaines économiques et sociaux (New Deal), il commande une étude sur les grandes tendances sociales. Puis ce sera essentiellement pour répondre à des préoccupations militaires, dès les années 1940, que se développeront les premiers travaux de prospective. L'armée de l'air américaine demande ainsi à Theodore von Kármán une étude sur les progrès techniques qui pourraient avoir un intérêt militaire (Towards New Horizons, 1947), et surtout confie, quelques années plus tard, à Douglas Aircraft, la responsabilité d'un projet de recherche-développement (projet RAND) sur les aspects non terrestres des conflits internationaux.
En France, dès la fin des années 1950, Gaston Berger réinvente le terme de prospective dans un article paru dans La Revue des deux mondes (n° 3, 1957). En 1960, Bertrand de Jouvenel forge le concept de « futuribles », et crée le Comité international Futuribles. L'un et l'autre sont animés de préoccupations plutôt humanistes et sociales. Les travaux de prospective sont alors publiés dans deux publications : la revue Prospective du Centre d'études prospectives de Gaston Berger, et les bulletins « Futuribles » publiés par la SÉDÉIS (Société d'études et de documentation économiques, industrielles et sociales) à partir de 1960.
« Il ne sert à rien de prévoir ce qui se passerait. L'important est de prévoir ce qui se passerait si l'homme ne faisait rien pour changer le cours des choses. » Ces lignes sont de Gaston Berger (1896-1960), un philosophe assez peu étudié mais qui a inventé et développé une discipline chère aux économistes**:** la prospective. Celle-ci ne saurait se donner pour but de faire des prédictions exactes sur l'avenir – celui-ci étant incertain, laissons cela aux voyantes, recommande Berger. La prospective est d'abord une certaine « attitude » que l'on prend par rapport au présent et elle consiste à se demander où nous conduiraient les tendances actuelles si nous ne faisons rien. En cela, faire de la prospective revient à étudier le présent dans le but d'agir sur celui-ci.
L'étude des futurs possibles
« La prospective » en tant que substantif apparaît dans les années 1960 et renvoie aux travaux sur l'avenir qui se développent dans la sphère publique, principalement aux États-Unis et en France. Cette époque est celle de la création de nombreux organismes dédiés à la prospective, sur des initiatives soit privées, soit publiques. Dans tous les cas, les soutiens publics et ceux des grandes fondations ou entreprises sont essentiels au développement de ces organismes.
En France, l'association internationale Futuribles est créée en 1968 et poursuit les travaux du Comité international Futuribles et ceux du Centre d'études prospectives de Gaston Berger (décédé en 1960). Elle entretient des liens de plus en plus étroits avec le Commissariat général du Plan et avec la DATAR (Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) qui sont les deux principaux instigateurs de démarches de prospective au service de l'élaboration des politiques publiques (les Plans, l'aménagement du territoire).
À l'échelle européenne et internationale, c'est aussi la conscience des grands enjeux mondiaux et le mouvement pacifiste qui portent le développement de la prospective. On peut ainsi mentionner le groupe Mankind 2000 créé par Robert Jungk en collaboration avec James Wellesley-Wesley, ou encore les travaux du pacifiste Johan Galtung.
Dans les années 1960 et 1970, de très nombreuses méthodes formalisées de prospective voient le jour. Des discussions méthodologiques très riches animent la communauté des prospectivistes et des planificateurs. On trouve dès cette période une diversité d'approches, y compris dans les modalités d'élaboration et les usages des scénarios. Ainsi Herman Kahn insiste-t-il sur l'intérêt des scénarios très « tendanciels » tandis qu'Hasan Özbekhan inverse le cheminement traditionnel et développe des scénarios « d'anticipation » qui partent du futur pour aboutir au présent.
Longtemps assimilée à la méthode des scénarios, une méthode qui a fait ses preuves mais qui est coûteuse en temps et nécessite une participation assidue de la part de ses parties prenantes, la prospective compte désormais de nombreux outils et méthodes permettant de réaliser des travaux plus courts, plus rapides, avec une participation réduite et qui s'agencent davantage avec des agendas chargés et raccourcis. L'idée étant de capter, de captiver et de mobiliser un auditoire et des équipes, plus rapidement.
Le recours au récit et à la fiction est l'une de ces méthodes. Elle permet une immersion rapide et efficace, elle met ses interlocuteurs sur un pied d'égalité face à un futur proposé, et sa distance avec la réalité favorise et suscite le débat.

Les enjeux contemporains de la prospective
Face à la multiplication des incertitudes et des crises, les démarches prospectives sont de plus en plus sollicitées avec des objectifs variés : préparer les organisations aux changements, nourrir des stratégies de résilience, bâtir des stratégies de long terme, susciter des innovations, accompagner les « transitions », etc. La prospective semble en effet plus que jamais nécessaire dans sa double dimension : celle de l'anticipation (« que peut-il advenir ? ») et celle de l'action (« que pouvons-nous faire ? »).
Les techniques et méthodes contemporaines
Les techniques disponibles se sont diversifiées et modernisées : SWOT prospectif, design fiction, analyse des signaux faibles, méthodes participatives, etc.
Le SWOT prospectif
Le SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) est un outil d'analyse stratégique qui prend en compte les Forces et Faiblesses actuelles d'une organisation face aux Opportunités et Menaces potentielles qui se profilent sur son marché et son environnement global. L'analyse externe permet d'identifier les facteurs clés de succès du marché à horizon 3 à 5 ans en moyenne, voire plus pour de la prospective stratégique d'entreprise. L'analyse des Forces et des Faiblesses permet de déterminer quels sont les enjeux stratégiques face aux Opportunités et Menaces potentielles. Dans sa version prospective, cet outil intègre une dimension temporelle et exploratoire qui dépasse le simple diagnostic statique.
Le design fiction
Le design fiction vise à « éviter de laisser les autres choisir le futur à votre place ». Cette méthode consiste à créer des objets, services ou expériences fictionnels mais plausibles pour explorer les implications futures de choix technologiques ou sociétaux actuels. En matérialisant des futurs possibles à travers des prototypes narratifs, le design fiction permet aux organisations d'anticiper les usages et les conséquences de leurs innovations.

L'analyse des signaux faibles
Une autre méthode fondamentale consiste à identifier et analyser des signaux faibles.
Un signal faible est un ensemble de données non structurées qui indique des changements à venir dans l'environnement. Ces signaux, bien que souvent mineurs en apparence, peuvent annoncer des événements majeurs. Ils sont généralement incertains, noyés dans le bruit, imprécis et fragmentaires. L'étude des signaux faibles peut aider les organisations à se préparer de manière à ce que les changements stratégiques soudains perdent de leur caractère imprévu, urgent et mystérieux.
L'identification des signaux faibles nécessite une veille permanente et transversale, mobilisant des sources d'information variées : publications scientifiques, brevets, réseaux sociaux, comportements émergents, innovations de niche, etc. Cette méthode, popularisée par Igor Ansoff dans les années 1970, reste aujourd'hui l'un des piliers de la prospective stratégique.
Les méthodes participatives
La prospective contemporaine privilégie également les approches participatives qui impliquent les parties prenantes dans la construction des scénarios futurs. Ces méthodes incluent les ateliers de créativité, les techniques de brainstorming structuré, les jeux sérieux, ou encore les démarches de prospective citoyenne qui associent les usagers et la société civile à la réflexion sur l'avenir.
Défis et limites
Malgré ses atouts, la prospective fait face à plusieurs défis contemporains : l'accélération du changement qui raccourcit l'horizon de prédictibilité, la complexité croissante des systèmes, les biais cognitifs des analystes, et le risque de paralysie face à la multiplicité des futurs possibles. Ces limites plaident pour une prospective humble, itérative et constamment révisée, qui assume l'incertitude plutôt que de prétendre la réduire.
Innover et préparer aux changements majeurs
L'innovation est pour le capitalisme une référence idéologique centrale. Elle est perçue non seulement comme un moteur essentiel de la croissance économique, mais aussi comme une solution aux défis du développement durable, aux crises sanitaires et aux difficultés sociales (on parle d'« innovation sociale » à ce sujet). C'est un processus qui commence dans le présent et qui cherche à influencer et à modeler l'avenir. L'innovation implique l'introduction d'un produit, d'une méthode ou d'une idée novatrice dans le présent, avec le potentiel de transformer et de définir l'avenir.
La prospective est une démarche qui consiste à anticiper et préparer l'avenir en élaborant des scénarios basés sur des analyses réfléchies pour éclairer les décisions actuelles. C'est également une attitude vis-à-vis de l'avenir, le considérant comme largement constructible et non entièrement prédéterminé. La science-fiction porteuse d'espoir (ex : Solarpunk) et la prospective partagent un objectif commun : repenser le monde pour le transformer en un lieu où l'humanité serait plus heureuse.
En toute liberté et responsabilité, SF et prospective nous invitent à imaginer et à oser. La science-fiction, cependant, se distingue de la prospective par sa plus grande liberté dans les spéculations sur les découvertes et les innovations futures. La science-fiction cherche dans l’ailleurs ce que la prospective cherche dans l’avenir : une autre manière de penser le monde pour le transformer peu à peu en un univers dans lequel l’homme qui y vit serait plus heureux. Elle permet aussi d'anticiper les évolutions technologiques, de préparer psychologiquement aux changements majeurs et de façonner l'imaginaire collectif.

Enracinée dans le présent, l'innovation façonne le futur.
L'homme bionique n'en est plus simplement au stade de projet. La Chine mise sur des « surhommes » génétiquement améliorés qu’elle espère envoyer un jour dans son palais lunaire. Jeff Bezos, le patron d'Amazon travaille d'arrache-pied à la création d'entrepôts logistiques en apesanteur. Elon Musk, le fondateur de Tesla à qui l'on prête une vision comparable à celle de Thomas Edison, a choisi Mars comme destination finale de sa fusée Falcon Heavy. Et si la science-fiction dépassait la réalité ? Pour répondre, que pouvions nous faire de mieux que d'interroger Agnès Zevaco l'auteur du livre : Voyage au centre de la Tech.

La Science-Fiction et l'anticipation des changements.
La science-fiction permet d'anticiper les évolutions technologiques, de préparer psychologiquement aux changements majeurs et de façonner l'imaginaire collectif. Son apparition dans les grandes puissances impérialistes ou coloniales comme la France, l'Angleterre, la Chine, le Japon, et la Russie à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'aux États-Unis dans les années 1930 et 1940, n'est pas un hasard. En effet, la science-fiction reflète la conscience collective des sociétés qui se questionnent sur leur responsabilité face à l'avenir de l'humanité.



Bien plus qu’un plan de communication, ces projets numériques et technologiques sont de réelles stratégies afin de préparer une ère post-industrielle de ces pays du Golfe. Comme l’explique David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques : "Il y a un point commun à l'ensemble de ces pétromonarchies, c'est la prise de conscience et l'anticipation d’un horizon post-pétrolier. Ils entament une transition en utilisant la manne pétrolière actuelle, pour financer une multitude de projets à vocation numérique."

Des questions auxquelles répondront David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Clarence Rodriguez, ancienne journaliste correspondante en Arabie Saoudite et Alain Musset, géographe membre de l’Institut Universitaire de France
Et si demain était déjà écrit ?
Des interviews de Pierre-Antoine Marti, consultant chez Labbrand et doctorant en histoire à l’EHESS. La thèse qu’il écrit est joliment intitulée « Il sera une fois… ». Elle a pour ambition d’analyser d’un point de vue historique les représentations du futur dans la science-fiction du XX siècle.

Et si un bon livre de SF pouvait vous aider avec votre business plan ?
Quand l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov prédisait le futur
Des robots à l'intelligence artificielle, de l'ordinateur à Internet, l'écrivain de science-fiction a laissé derrière lui une œuvre visionnaire, ayant anticipé, 50 ans avant tout le monde, nombre des évolutions technologiques de notre temps.
Un prophète Asimov ? Un devin ? Peu d’auteurs de science-fiction ont dépeint avec autant de précision le futur. Né en 1922, Isaac Asimov est encore considéré comme l'un des plus grands auteurs de science-fiction, à la fois en raison de ses romans et nouvelles consacrés aux robots, qui mettaient en scène, bien avant leur existence concrète, les problématiques que poserait l’intelligence artificielle, mais également en raison de son grand cycle de roman Fondation, ayant remporté en 1966 l’unique prix Hugo de science-fiction de “Meilleure série de tous les temps”.
Dans ses récits, l'écrivain russo-américain se plaisait à imaginer un futur lointain, où l'humanité avait d'ores et déjà conquis les étoiles. Mais il s'était également essayé à la prospective, de façon bien moins lointaine. En 1964, Isaac Asimov s'imaginait ainsi à quoi pourrait bien ressembler le futur 50 ans plus tard, en 2014, dans un texte traduit par le site Framablog. Un exercice auquel il s'était à nouveau adonné en 1984, dans une interview accordée au quotidien canadien Toronto Star où il imaginait cette fois l’année 2019. Sa vision globale de la technologie et de ses enjeux lui conférait, en la matière, une étonnante acuité.

"Il est difficile de ne pas reconnaître à Asimov un talent de visionnaire. Renseigné, il extrapolait avec talent les données en sa possession pour en déduire un futur probable. A croire qu’il était, lui-même, une sorte de psycho-historien. Pour sauver l’humanité, il ne reste donc plus qu’à inventer la discipline." Pierre Ropert